Pendant longtemps, j’avais qualifié cet épisode « la grotte de la vierge et les fusils du jardin ». Dans mes souvenirs, deux moments très différents se superposaient à tort.
Il y avait d’une part cet après midi au cours duquel mon père m’avait emmené avec lui pour procéder à la visite finale de travaux qu’il avait réalisés dans la cour du presbytère pour le compte de la paroisse.
Dans le coin de cette cour qui abritait le patronage tous les jeudis après midi, il avait à la demande du curé du village réalisé une "vierge dans la grotte" qui servirait de point final aux processions du mois de Marie et du quinze août.
Maçon réputé pour sa capacité à travailler le ciment, mon père s’était fait une spécialité du faux bois en béton dont nombre de maisons d’Aïn-El-Arba étaient décorées, mais aussi de la réalisation de grottes aux rochers colorés imitant parfaitement les replis torturés de l’anfractuosité naturelle qui servit de décor à l’apparition de la vierge de Lourdes.
Nous étions donc, au cours de cet après midi, dans la cour déserte du presbytère mon père et moi accompagnés de Romain, une sorte de factotum de la paroisse en train de contempler les œuvres paternelles et à gloser sur la qualité symbolique et représentative de cette grotte plus vraie que nature.
J’écoutais avidement les dialogues des grands, m’imprégnant de tout ce qui se disait, goûtant avec autant d’avidité le plaisir d’avoir été admis dans cette cour à laquelle nous n’avions accès que le jeudi après midi.
Un peu à l’écart des deux adultes que j’accompagnais, je revoyais nos jeux des derniers jeudis, jeu du foulard, balle au prisonnier, délivrance, et autres saynètes auxquels l’imagination débordante des jeunes gens qui nous surveillaient nous soumettait.
Mais déjà, même dans cette collectivité rurale que nous formions, la télévision avait fait son apparition, et nous étions quelques uns à chercher pendant ces après midis encadrés, des raisons d’y échapper pour en fait nous réfugier chez Fernande, la gouvernante du curé et la sœur de Romain pour regarder Mire et Disques.
Et le vendredi matin, dans la cour de l’école, nous étions quelques uns à snober les autres leur disant :
- tu n’as pas vu Mire et Disques ?
Cette grotte à la vierge dans la cour du presbytère s’était transportée, dans mes souvenirs, au fond de notre jardin, contre le mur de pierre jointoyées recouvert d’une vigne qui séparait notre maison de celle de Pascual Belda.
Je m’interroge encore sur la raison de cette confusion entre deux souvenirs distincts, bien identifiés dans le temps et dans les événements qu’ils concernent.
Une première raison tient sans doute au décor, les vieilles pierres du mur rappelant de façon étrange le décor en ciment coloré imaginé par mon père pour la grotte du presbytère.
J’avoue que l’idée d’une grotte à la vierge dans le fond de notre jardin m’a toujours paru une éventualité plausible dans cette partie éloignée du jardin propice au recueillement.
Une deuxième raison tient peut être au fait que mon père était accompagné de Romain dans un cas et de mon Oncle Joseph dans l’autre.
La confusion entre les deux personnages peut s’expliquer par une analogie formelle, leurs habitudes de grands fumeurs, et aussi leur propension à tout conceptualiser pour proposer des théories opérationnelles sur la plupart des événements les plus anodins soient ils.
Toujours est il que j’assistais peu avant notre départ aux efforts de mon père et de mon oncle, dans le jardin, sans grotte à la vierge, pour dégager le regard de la fosse septique enfoui sous quelques centimètres de terre, et y enterrer des fusils dont ma mère m’apprenait quelques années plus tard qu’ils étaient les fusils du curé.
Le Curé était un personnage central du village. La majorité des habitants, d’origine espagnole, venus d’une immigration antérieure à celle de 1936 étaient tous catholiques pratiquants. La vie culturelle du village s’organisait autour de l’église et de la paroisse.
La paroisse publiait et diffusait un bulletin qui relatait les événements principaux de la vie de la collectivité, annonçait les fêtes et les manifestations religieuses, relayait les prêches du Curé. Ce bulletin avait été baptisé Epis et Grappes pour signifier la forte dimension rurale et agricole de notre collectivité. Ces symboles de l’épi et de la grappe faisaient référence aux évangiles qui présentent les épis et les grappes comme les dons de la nature et du créateur. Autre signification de ce symbole, l’unité et la solidarité, , chaque grain de blé et chaque grain de raisin ne pouvant exister sans les autres au sein de l'épi ou de la grappe.
Le curé J diffusait autour de lui cette culture de l’unité de la solidarité de l’entraide, et la faisait vivre par sa présence et par la façon dont il concevait son ministère.
Les fêtes religieuses donnaient toujours lieu à des manifestations visibles, processions, cérémonies chantées, lectures et réflexion commune des évangiles mais aussi d’œuvre choisies pour leur caractère édifiant.
Nous étions assez sensible à ces fêtes et y participions de façon active. La procession des rameaux étaient l’occasion de fabriquer des palmes qui supportaient toutes sortes de décorations et de cadeaux. C’était à qui aurait la plus grande et la plus chargée. Ma jeune cousine Ilda Rose, elle devait avoir 4 ans cette année là, nous avait accompagné à la procession des rameaux, en chantant au clair de la lune et en mangeant les œufs en sucre et en chocolat qui décoraient nos palmes et la sienne.
Ce jour là, le Curé avait évoqué dans son sermon, la vocation de mon frère Damien qui était au petit séminaire d’Oran, et la nécessité pour la collectivité de se mobiliser pour soutenir et favoriser l’accession d’un jeune du village au sacerdoce.
La paroisse gérait également un cinéma, le seul cinéma du village, dont les programmes étaient soigneusement sélectionnés et visionnés avant leur diffusion.
L’opérateur de la salle était Auguste communément appelé Sordo à cause de sa surdité. Il était le cousin du père de notre tante Régine. Il s’occupait également de la voirie et notamment de la gestion de l’eau dans la commune. Grâce à lui nous étions au courant de la programmation de la salle de cinéma.
La censure du curé présentait quelquefois des défaillances, ou suscitait des mouvements d’humeur dans la salle.
Lors de la projection du film le Chevalier d’Eon nous avons tous vus avec stupeur un sein fugitif qui semblait avoir échappé à la vigilance de notre prêtre.
A l’inverse un autre film italien, Donatella qui raconte l’histoire d’une jeune fille à la vie amoureuse tourmentée, avait subi de nombreuses coupures qui avait provoqué des réactions houleuses dans le parterre.
J’avais reconnu dans les manifestations la voix de mon frère Sébastien qui avait à plusieurs reprises crié :
- Da le tela !
Une locution difficilement traduisible qui joue sur l’analogie phonique avec le titre Donatella et qui signifie en gros donne lui une raclée.
Pourquoi précisément, sous les boiseries de la gare de Lyon Perrache penser à ces événements qui avaient précédé notre départ pour Oran ?
Peut être, pour compenser l’impression que dégageait ce bâtiment inhospitalier et austère, et la déception que procurait un endroit bruyant et sale sans lumière, qui contrastait avec l’idée que nous nous faisions d’une gare française.
Très vite pourtant nous dépassions nos déconvenues, je crois qu’elles étaient partagées, pour nous fixer sur notre but final, Bourges.
Il nous fallait dans un temps limité, trouver à nous restaurer, identifier le train que nous devions prendre et transporter notre groupe vers la maison que nous imaginions accueillante de ma tante Antoinette.
Assis sur des bancs de bois, sous les immenses boiseries brunes qui rajoutaient au côté sombre du lieu, nous déjeunions de hot dogs et de vache qui rit, nourriture que nous avions trouvée auprès d’un marchand ambulant.
Un jeune garçon et son père étaient venus s’installer près de nous, et semblaient étonnés de l’apparence de notre groupe et surtout de notre accent.
L’homme se cachait derrière un journal, jetant des coups d’œil à la dérobée, une Gitane maïs au bout des lèvres.
Le jeune garçon, il devait avoir mon âge, m’observait de façon soutenue comme si j’étais un sujet d’étonnement.
Son père le rabrouait de son journal pour l’obliger à se concentrer sur son repas, des vaches qui rit également.
Ils en vinrent à se battre, sans succès, avec l’emballage en papier aluminium de la portion que le jeune garçon essayait de manger.
Finalement sur les conseils de son père, il décida de porter la pointe du triangle de fromage, sans la déballer, dans sa bouche, et de l’aspirer en pressant la base des ses doigts.
Le résultat ne fut pas à la hauteur de ce qui était attendu, vu la quantité de fromage sur les doigts du garçon et la colère du père qui semblait reprocher à son fils de se conduire ainsi devant nous.
Cet événement me laissait perplexe quant aux coutumes de ces vrais français avec lesquels nous allions vivre, nous qui nous vivions avec cette crainte de ne pas apparaître digne de cette France métropolitaine, comme nous disions, qui nous accueillait les bras pas complètement ouverts.
Le voyage en train reprit et la consommation de cigarettes mentholées avec.
Nous somnolions tous dans notre compartiment, transportant chacun dans nos pensées et nos rêves une part d’Algérie que nous voulions jalousement garder comme un réconfort personnel pour affronter ce qui nous attendait.
En regardant mes compagnons de voyage, je les replaçais chacun dans un contexte différent de celui du compartiment du train.
Cela les reliait à des événements à des lieux à des personnes que j’avais moi vécu et connus.
Pour la première fois dans ce train je passais en revue différents événements que je situais mentalement chacun dans un endroit de la maison ou du village pour essayer de ne pas oublier.
Cet exercice de mémoire ne m’a plus quitté dès lors, et je suis toujours étonné de la permanence de ces souvenirs, et de leur caractère récurrent.


 C’est en 1961 je crois, que notre maison accueillait la dépouille d’un autre oncle, Raymond, emporté par la maladie, le mari d’une sœur de ma mère à laquelle nous étions très attachés.
C’est en 1961 je crois, que notre maison accueillait la dépouille d’un autre oncle, Raymond, emporté par la maladie, le mari d’une sœur de ma mère à laquelle nous étions très attachés.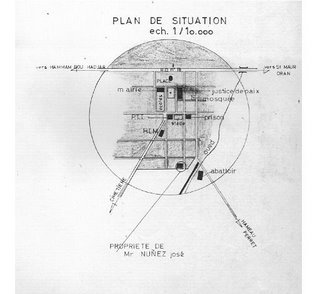 C’est dans cette maison qu’un matin, très tôt, Maman nous avait tous fait lever pour partir.
C’est dans cette maison qu’un matin, très tôt, Maman nous avait tous fait lever pour partir. On aimait bien Raymond, d'abord à cause de ses faux airs à la fois de Paul Newman et de Steve Mac Queen, ensuite parce que son coté américain était renforcé par le fait qu'il portait le même prénom que son père, une sorte de Junior, quelque 40 années avant la mode.
On aimait bien Raymond, d'abord à cause de ses faux airs à la fois de Paul Newman et de Steve Mac Queen, ensuite parce que son coté américain était renforcé par le fait qu'il portait le même prénom que son père, une sorte de Junior, quelque 40 années avant la mode.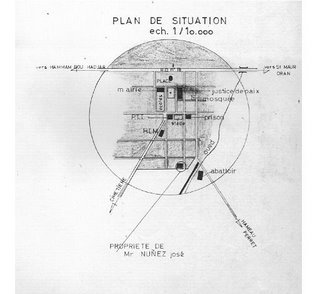
 Une certitude nous étreignait alors, celle qu’un jour nous aussi nous rejoindrions ce lieu de repos.
Une certitude nous étreignait alors, celle qu’un jour nous aussi nous rejoindrions ce lieu de repos.  J'habitais depuis près de huit ans dans ce village lorsque je pris conscience de sa réalité.
J'habitais depuis près de huit ans dans ce village lorsque je pris conscience de sa réalité. Ouafya, la fille de Bachir, habitait avec sa famille en face de notre maison, de l'autre côté de l'oued qui traversait le village, vers la remonte. Cet Oued avait été canalisé par un magnifique ouvrage en béton qui lui donnait une fière allure de canal.
Ouafya, la fille de Bachir, habitait avec sa famille en face de notre maison, de l'autre côté de l'oued qui traversait le village, vers la remonte. Cet Oued avait été canalisé par un magnifique ouvrage en béton qui lui donnait une fière allure de canal. Prêt de 57 années après la photo de Melchior le magnifique, nous avons une photo de Melchior l'ancien à l'âge de 72 ans. On le distingue dans le flou de cette salle de restaurant de l'Ardèche profonde, à l'occasion du mariage d'une de ses arrières petites nièces. Sa posture bien connue de fumeurs de "puros", avec le bras dont la main tient le cigare, légèrement replié, et l'air inspiré de celui qui avale la vie comme l'on avale la fumée des havanes. 3 ans avant la chanson de Gainsbourg, Dieu est un fumeur de havanes, Melchior notre Dieu avait déjà fumé un nombre non communiqué de ces cilindres cubains au parfum entêtant.
Prêt de 57 années après la photo de Melchior le magnifique, nous avons une photo de Melchior l'ancien à l'âge de 72 ans. On le distingue dans le flou de cette salle de restaurant de l'Ardèche profonde, à l'occasion du mariage d'une de ses arrières petites nièces. Sa posture bien connue de fumeurs de "puros", avec le bras dont la main tient le cigare, légèrement replié, et l'air inspiré de celui qui avale la vie comme l'on avale la fumée des havanes. 3 ans avant la chanson de Gainsbourg, Dieu est un fumeur de havanes, Melchior notre Dieu avait déjà fumé un nombre non communiqué de ces cilindres cubains au parfum entêtant.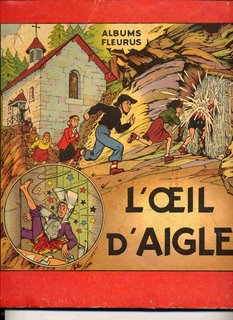 A l'été 1960 ou 1961, nous étions tous à la colonie du curé, la cité ardente. La colo avit un hymne qui disait :
A l'été 1960 ou 1961, nous étions tous à la colonie du curé, la cité ardente. La colo avit un hymne qui disait : A l'image de Béatriz et Rosa, les deux soeurs mythiques dont les maris s'étaient embarqués, l'un en 1909 pour l'Algérie, l'autre en 1922 pour Rio de la Plata en Argentine, Denise et Antoinette, leurs petites nièces, ont vécu à leur façon une saga aussi héroïque.
A l'image de Béatriz et Rosa, les deux soeurs mythiques dont les maris s'étaient embarqués, l'un en 1909 pour l'Algérie, l'autre en 1922 pour Rio de la Plata en Argentine, Denise et Antoinette, leurs petites nièces, ont vécu à leur façon une saga aussi héroïque. Nous avions longtemps hésiter avant de comprendre que los "Puros" signifiait en fait los puros de la Habana, des cigares Havane "purs", des vrais de vrai venus de la Havane, pays mythique, dans lequel notre arrière Grand Père était parti faire la guerre contre les Américains en 1905. Tcha Tché, Melchior le magnifique, avait repris cette tradition qui nous hante encore, de fumer à longueur de journée, d'énormes cigares qui exhalaient une fumée blanche épaisse et une odeur entêtante au dessus des tables de billard. Car avec los"Puros", il y avait le bar du village, les dimanches après la messe, où, enfants nous accompagnions nos parents pour les regarder jouer, boire, rire et parler de choses qui nous dépassaient mais dont nous savions qu'un jour nous allions aussi en parler autour d'un billard avec un "puro" et un verre d'anisette.
Nous avions longtemps hésiter avant de comprendre que los "Puros" signifiait en fait los puros de la Habana, des cigares Havane "purs", des vrais de vrai venus de la Havane, pays mythique, dans lequel notre arrière Grand Père était parti faire la guerre contre les Américains en 1905. Tcha Tché, Melchior le magnifique, avait repris cette tradition qui nous hante encore, de fumer à longueur de journée, d'énormes cigares qui exhalaient une fumée blanche épaisse et une odeur entêtante au dessus des tables de billard. Car avec los"Puros", il y avait le bar du village, les dimanches après la messe, où, enfants nous accompagnions nos parents pour les regarder jouer, boire, rire et parler de choses qui nous dépassaient mais dont nous savions qu'un jour nous allions aussi en parler autour d'un billard avec un "puro" et un verre d'anisette.