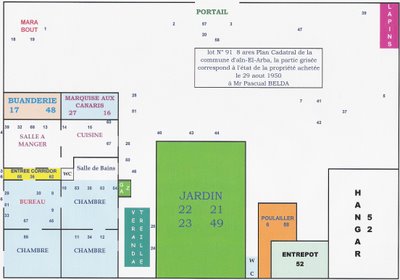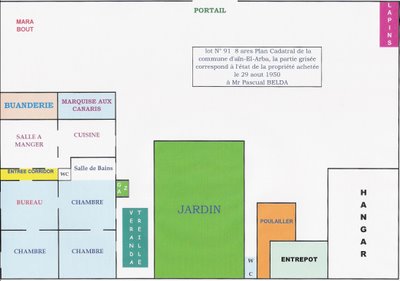L’appartement, quasiment vide, ma tante et mes deux cousines étant déjà parties pour la France, ajoutait au caractère désolant de tout ce que nous venions de vivre.
La salle à manger éclairée par la lumière d’un immense balcon donnant sur la ville et au loin le port, semblait ridicule avec cette table de formica vert pale aux pieds en alu, qui siégeait de façon incongrue en son milieu.
Aussitôt arrivés, nous avons déposé nos bagages ; je me souviens très bien de ma petite valise de carton bouilli beige avec des coins renforcés d’une couleur plus foncée, et de la ménagère, cadeau de mariage des mes parents que mon frère Damien devait surveiller comme la prunelle de ses yeux ; pour repartir vers le port de tourisme dans la 4CV bleu pétrole de mon oncle François.
En chemin, celui ci, pour nous faire gagner du temps, soi disant, avait choisi un itinéraire improbable par des rues connues de lui seul, et dans lesquelles nous nous heurtions inévitablement à des barrages militaires.
Sans hésiter, il choisissait une solution de contournement en nous disant qu’il maîtrisait la situation et adressait, alors qu’il tournait brutalement à droite ou à gauche avant le barrage, un message en morse à l’aide de son klaxon en répétant à voix haute son contenu supposé.
Nous avons bien vu quelques fois les militaires lever les bras au ciel en montrant la 4CV, mais la méthode s’est avérée efficace puisque nous sommes arrivés sans encombre au port.
La foule immense qui attendait a refroidi, quelques instants, notre ardeur, mais mon père, infatigable optimiste, nous dit :
La salle à manger éclairée par la lumière d’un immense balcon donnant sur la ville et au loin le port, semblait ridicule avec cette table de formica vert pale aux pieds en alu, qui siégeait de façon incongrue en son milieu.
Aussitôt arrivés, nous avons déposé nos bagages ; je me souviens très bien de ma petite valise de carton bouilli beige avec des coins renforcés d’une couleur plus foncée, et de la ménagère, cadeau de mariage des mes parents que mon frère Damien devait surveiller comme la prunelle de ses yeux ; pour repartir vers le port de tourisme dans la 4CV bleu pétrole de mon oncle François.
En chemin, celui ci, pour nous faire gagner du temps, soi disant, avait choisi un itinéraire improbable par des rues connues de lui seul, et dans lesquelles nous nous heurtions inévitablement à des barrages militaires.
Sans hésiter, il choisissait une solution de contournement en nous disant qu’il maîtrisait la situation et adressait, alors qu’il tournait brutalement à droite ou à gauche avant le barrage, un message en morse à l’aide de son klaxon en répétant à voix haute son contenu supposé.
Nous avons bien vu quelques fois les militaires lever les bras au ciel en montrant la 4CV, mais la méthode s’est avérée efficace puisque nous sommes arrivés sans encombre au port.
La foule immense qui attendait a refroidi, quelques instants, notre ardeur, mais mon père, infatigable optimiste, nous dit :
- attendez là !
- je vais voir,
et comme chaque fois dans des situations identiques, il revenait souriant, alors que nous commencions à douter et à nous impatienter, en nous disant :
- ça y est j’ai les billets.
Le retour vers l’appartement fut moins chaotique, peut être parce que nous étions rassurés par la certitude de pouvoir partir vers la France, peut être aussi parce que ce voyage d’Aïn-El-Arba vers Oran puis ce périple dans Oran et cette attente au port nous avait quelque peu, déjà, endurcis.
L’appartement presque vide nous attendait, je ne sais plus très bien qui avait suivi le périple au port, je me souviens en avoir été, peut être mon frère Damien aussi, peut être mon oncle Joseph également, je ne sais plus.
Je ne dirais rien sur le dîner de ce soir là, car je me demande s’il y a eu un dîner.
Mon oncle parti prendre son service de nuit nous avait donné quelques recommandations en nous assurant qu’il serait, de bonheur, présent le lendemain.
Dans la nuit oranaise, nous peinions à trouver le sommeil, chacun concentré je le supposais, sur les événements des journées qui venaient de s’écouler et de celles qui allaient venir.
je pensais fixement à ma mère restée seule avec l’oncle et Mathilde, me demandant si j’allais la revoir un jour.
Bizarrement, alors que j’étais assez sensible, habituellement, à son absence, je parvins à ne pas pleurer.
Je considérais, dans ma jeune tête, les événements à venir dont j’ignorais tout, mais dont je sentais instinctivement, qu’ils se dérouleraient comme les précédents, sous le signe d’une providence bienveillante, dont les responsables m’apparaissaient précisément être mes parents, et mon père surtout.
Avec le temps, je maintiens ce sentiment récurrent d’une protection familiale quasi divine qui nous vient de loin, forgée par la geste de la saga familiale, marquée par de nombreux épisodes de migration, d’abandon et d’installation dans des positions et des pays nouveaux.
La nuit s’était installée et l’appartement soupirait des respirations fortes de ses occupants qui cherchaient à masquer dans un sommeil réel ou feint, des angoisses que je connaissais moi même.
Pour accompagner ces bruits intérieurs, la rue nous répliquait en émettant des bruits divers, plus inquiétant les uns que les autres, voitures hurlantes, piétinements, courses poursuites, cris, coups de feu lointains, comme pour nous rappeler à la réalité de notre situation.
Nous étions couchés depuis peu de temps, une heure peut être, lorsque…je vais relater là un fait qui reste une légende familiale mais qui est une réalité... lorsque des coups faibles retentirent à la porte d’entrée.
Je ne sais plus qui se leva pour aller ouvrir, après avoir écouté pour évaluer l’éventuel danger que représentait ce visiteur inattendu et nocturne, mais nous fûmes plusieurs, debout devant la porte ouverte, pour regarder avec stupéfaction une voisine de notre oncle François dans un déshabillé vaporeux, une énorme clef anglaise à la main demandant si François était là, car elle devait lui rendre cet outil de toute urgence…
Le retour vers l’appartement fut moins chaotique, peut être parce que nous étions rassurés par la certitude de pouvoir partir vers la France, peut être aussi parce que ce voyage d’Aïn-El-Arba vers Oran puis ce périple dans Oran et cette attente au port nous avait quelque peu, déjà, endurcis.
L’appartement presque vide nous attendait, je ne sais plus très bien qui avait suivi le périple au port, je me souviens en avoir été, peut être mon frère Damien aussi, peut être mon oncle Joseph également, je ne sais plus.
Je ne dirais rien sur le dîner de ce soir là, car je me demande s’il y a eu un dîner.
Mon oncle parti prendre son service de nuit nous avait donné quelques recommandations en nous assurant qu’il serait, de bonheur, présent le lendemain.
Dans la nuit oranaise, nous peinions à trouver le sommeil, chacun concentré je le supposais, sur les événements des journées qui venaient de s’écouler et de celles qui allaient venir.
je pensais fixement à ma mère restée seule avec l’oncle et Mathilde, me demandant si j’allais la revoir un jour.
Bizarrement, alors que j’étais assez sensible, habituellement, à son absence, je parvins à ne pas pleurer.
Je considérais, dans ma jeune tête, les événements à venir dont j’ignorais tout, mais dont je sentais instinctivement, qu’ils se dérouleraient comme les précédents, sous le signe d’une providence bienveillante, dont les responsables m’apparaissaient précisément être mes parents, et mon père surtout.
Avec le temps, je maintiens ce sentiment récurrent d’une protection familiale quasi divine qui nous vient de loin, forgée par la geste de la saga familiale, marquée par de nombreux épisodes de migration, d’abandon et d’installation dans des positions et des pays nouveaux.
La nuit s’était installée et l’appartement soupirait des respirations fortes de ses occupants qui cherchaient à masquer dans un sommeil réel ou feint, des angoisses que je connaissais moi même.
Pour accompagner ces bruits intérieurs, la rue nous répliquait en émettant des bruits divers, plus inquiétant les uns que les autres, voitures hurlantes, piétinements, courses poursuites, cris, coups de feu lointains, comme pour nous rappeler à la réalité de notre situation.
Nous étions couchés depuis peu de temps, une heure peut être, lorsque…je vais relater là un fait qui reste une légende familiale mais qui est une réalité... lorsque des coups faibles retentirent à la porte d’entrée.
Je ne sais plus qui se leva pour aller ouvrir, après avoir écouté pour évaluer l’éventuel danger que représentait ce visiteur inattendu et nocturne, mais nous fûmes plusieurs, debout devant la porte ouverte, pour regarder avec stupéfaction une voisine de notre oncle François dans un déshabillé vaporeux, une énorme clef anglaise à la main demandant si François était là, car elle devait lui rendre cet outil de toute urgence…