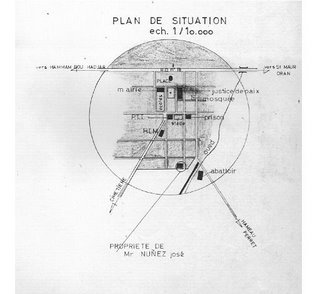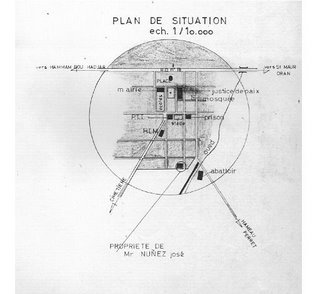 C’est dans cette maison qu’un matin, très tôt, Maman nous avait tous fait lever pour partir.
C’est dans cette maison qu’un matin, très tôt, Maman nous avait tous fait lever pour partir.Les bruits les plus fous avaient courus dans le village, quant à la nécessité pour les européens de partir sous peine de subir les représailles des arabes venus de la montagne.
Nous étions apparemment les derniers à devoir partir. Beaucoup de nos concitoyens, après avoir pris leurs précautions, envois de cadres remplis de meubles, par bateau, et d’argent vers la métropole, avaient gagné Oran puis de là, la France.
Mon père, toujours optimiste, avait son assurance. Le fait d’avoir employé des indigènes dans des conditions sociales décentes, créait selon lui une sorte d’obligation morale, qui avait fait dire à l’un de ses chefs d’équipe :
José, tant qu’on est là tu restes tranquille !
Dans ces moments de crise, cette assurance n’avait plus cours et la décision d’un départ, au moins provisoire, s’imposait pour le moment.
La stratégie familiale reposait encore une fois sur les femmes de la famille, Denise et Antoinette, les deux sœurs, descendantes fidèles de Rosa Damiana et Beatriz, qui avaient été amenées à prendre des décisions semblables 53 années plus tôt lorsqu’il s’était agi de quitter l’Espagne…
Antoinette avait rejoint Bourges dans le centre de la France. Bourges en raison de la proximité de cette ville avec l’orphelinat de la Police à Osmoy.
Dans cette ville elle avait commencé de constituer un réseau de relations autour de son employeur, la maison de draps et linges Planchon.
Régulièrement nous recevions des lettres de notre tante, que nous lisions le soir autour de la table ovale de la cuisine.
Elle nous relatait la perception des événements d’Algérie par les Français de la métropole, dans les conversations nous disait elle, les pieds noirs étaient tous taxés de vils exploiteurs qui payaient les arabes à coup de barre de fer.
Malgré l’adversité de la vie d’une jeune femme pied noir à Bourges, elle avait alors 42 ans, elle avait su prévoir les conditions d’accueil de sa famille.
Son logement de la cité du Beugnon, 2 rue du champ dur au sud de Bourges était prêt à recevoir la horde déferlante de ses frères sœur, oncle et neveux.
Pendant ce temps à Aîn-El-Arba, la partition de la famille s’organisait.
Manuel, le plus jeune frère, était parti à Besançon rejoindre sa belle famille avec femme et enfants.
Mon frère Sébastien, après un passage par Bourges devait les y rejoindre pour passer son bac.
Denise avait choisi de rejoindre sa sœur à Bourges et organisait dans la maison d’Aîn-El-Arba, le camp de base qui servirait de regroupement avant le départ vers la France.
Elle même, Melchior son grand oncle, et Mathilde notre future belle sœur resteraient dans la maison, tandis que Melchior le plus jeune frère de Papa avec Régine sa femme et ses 4 enfants ferait tourner si nécessaire l’entreprise familiale.
Papa, mon frère Damien et moi partions pour Bourges, rejoindre Antoinette.
Nous serions accompagnés de mon Oncle joseph, de son épouse Marinette de leurs deux enfants Michel et Noêl, et du père de Marinette Pablo Cabedo.
Ce matin là donc, notre mère nous avait levé plus tôt que d’habitude.
Nous étions en juin 1962, et comme nous sommes arrivés à Bourges le 13 de ce mois, les faits que je relate, se situent entre la fin du mois de mai et cette date.
Après un petit déjeuner rapide, nous étions prêts, je me souviens du matin blafard de ce presque été algérien, la lumière était blanche sans soleil, et un plafond de nuages gris cachait ce beau ciel bleu violet dont nous avions l’habitude.
La cuisine semblait déserte en raison de cette famille silencieuse réunie autour de la table, je ne me souviens même plus du bruits des bols et des cuillères, ni des paroles qui d’habitude s’échangeaient bruyamment.
Un dernier tour dans les pièces de la maison, me permit de fixer un dernière fois le bureau, les étagères cosy au dessus du petit canapé d’angle, la collection d’Ivanohé aux livres à la tranche verte barrée de doré.
Dans ma chambre j’ouvris une dernière fois le rabat de mon petit secrétaire pour y ranger des soldats de plombs en pensant, je ne sais pourquoi, qu’Ali Bou Basla mon concurrent direct du classement de la classe de CM1 viendrait jouer avec.
Cette pensée bizarrement ne m’attristait pas, je me disais que c’était peut être un moindre mal.
Le petit déjeuner termine, les bols lavés, les adieux expédiés, nous devions nous retrouver chez le Curé du village, Joseph Jimeznez, chez qui nous attendais M Ducotey son chauffeur , Fernande la gouvernante, et l’Aronde fourgonnette qui devait nous conduire à Oran.